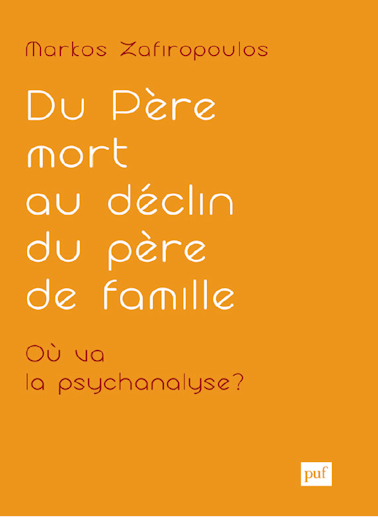Apocalypse Now !
Remarques à partir du livre de Markos Zafiropoulos[1]
Du père mort au déclin du père de famille
Où va la psychanalyse ?
par Gérard Pommier
Le livre de Zafiropoulos vient à point nommé pour un débat dont on espère qu’il aura lieu. Quel est le programme? Le bruit court que notre symbolique va mal. Ce «déclin» n’est pas même annoncé: il est considéré comme évident. Il fait écho à une note de fond médiatique agitant le spectre d’une crise généralisée, qui amalgame à plaisir l’économique, l’international, le familial, le climatique, le politique, etc. Le sous-titre du livre s’impose: «Où va la psychanalyse ?» Car quelles leçons tirer de cette apocalypse?
Selon une méthode qui laisse sa liberté au lecteur, Zafiropoulos se garde de critiques frontales – opinion contre opinion – mais il démonte l’archéologie des idées, celles de Freud, de Lacan ou de certains de ses élèves. En constatant cette évolution, chacun en tire des conclusions qui crèvent l’écran des évidences biaisées de l’actualité. Mais examinons d’abord les données.
En découvrant les faits, le lecteur naïf apprend qu’en dépit de sa chute annoncée, le père se porte bien. Si l’on en croit les statistiques, les idéaux du père mort ont toujours leur mot à dire en politique: par exemple, 75 % des catholiques pratiquants votent à droite, voire à l’extrême droite et, inversement, 66 % des personnes non religieuses votent à gauche[2]. Encore faut-il ajouter que la France est une exception notable dans un monde qui continue d’être déchiré par les affrontements religieux[3]. La carte des conflits mondiaux montre que les idéaux du père mort réunissent toujours les foules derrière leurs drapeaux, et partout où ces idéaux furent laïcisés, les Petits Pères des Peuples, de Napoléon à Staline, ont montré l’increvable constance de l’imposture paternelle. Nous sommes loin d’une période de l’histoire où dominerait un homme des Lumières, un homme de la science maître de son destin[4], ou au contraire un adolescent sans Dieu en proie à de nouvelles pathologies, en juste punition de son hubris.
Le père manigance toujours la situation derrière l’écran de cette société en décomposition que se plaisent à donner les médias et qu’accréditent un peu vite nombre de psychanalystes dans cette croyance. « Il n’y a plus de père ! L’autorité fout le camp! » Sur le terrain politique d’abord, qui pousse de tels gémissements? Ceux qui se prennent pour des pères, bien sûr, et dont l’imposture amuse les fils! C’est surtout l’expression répétée siècle après siècle de la haine de ces « pères » contre les fils auxquels ils promettent l’apocalypse, la fin des temps comme en l’an mil. Comme à l’heure de chaque Croisade où il fallut partir reconquérir le tombeau vide là-bas à Jérusalem[5]. Les hécatombes perpétrées au nom du père ou des idéaux du père mort furent légion au cours du xxe siècle et elles semblent se poursuivre avec autant d’ardeur à l’aube du nouveau millénaire. Quand ça le prenait, Lacan adorait jouer les pythies. Après notre mai 1968, il diagnostiqua que les étudiants n’attendaient qu’un vrai maître. Et plus tard, il pronostiqua que le xxie siècle serait celui d’un retour à la religion. S’il était présent, on peut parier qu’il n’opinerait certes pas à un « déclin du père ».
À bien y réfléchir, ce fameux « déclin » n’a-t-il pas commencé dès le début de l’humanité avec Totem et tabou? Le « festin cannibalique » fut son premier symbole, que chaque génération répéta à sa manière, inventant siècle après siècle de nouvelles présentations du parricide, toujours plus civilisées. L’eucharistie ne fut-elle pas un festin totémique, répété depuis à chaque Messe? Le parricide, donc le déclin du père, est la condition renouvelée de notre Symbolique, toujours changeant et souple, et notre époque ne déroge pas à la règle.
L’histoire de la «horde primitive» à la sauce Darwin n’aura été un mythe que le temps de sa découverte, le temps de sa mise en forme à tâtons par Freud, puis par Lévi-Strauss illuminant Lacan. Car ce « mythe » est la réalité psychique de chaque enfant, qui s’invente un loup, un animal phobique qu’il totémise, tout comme au premier temps de la horde[6]. Dans l’invention tâtonnante qui fut celle du « Père de la horde primitive», le déclin du père par totémisation fut une obligation pour les fils, s’ils voulaient sortir de leur vie confinée en «groupe homosexuel»: ce fut l’émergence à la fois de l’interdit de l’inceste, et d’une culpabilité fondatrice de la Loi, rappel toujours utile pour souligner que le père ne fait pas la Loi, mais qu’elle résulte de la culpabilité de son meurtre. Freud l’affirme avec simplicité et il n’en donna que quelques explications encore approximatives : car la culpabilité et l’interdit de l’inceste sont bien des faits universels, mais ces constats ne demandent-ils pas quelques explications? Le rappel de Zafiropoulos sur la constance du crime[7] est donc bienvenu, mais comment le comprendre ? Car pourquoi la culpabilité, s’il n’avait germé à l’aurore de la haine et en même temps qu’elle, une passion du père, « homosexuelle » en effet? Aucune culpabilité ne serait apparue si l’objet du meurtre n’avait été préalablement aimé, et si cette passion contaminée d’un désir incestueux horrifiant n’avait poussé au parricide. La culpabilité du meurtre est proportionnelle au « désir du père ». Comment comprendre autrement la succession de la haine motivant le parricide et de l’amour religieux qui lui succéda ? Amour nostalgique, mélancolique, pour un père qui ne reviendra pas, ou plutôt qui ne revient que par imposture et pour subir toujours le même funeste destin, faisant de sa figure celle d’une perpétuelle renaissance – Phénix au quotidien. La « Loi » de l’interdit de l’inceste devient claire : ce fut d’abord un inceste fantasmatique avec ce père trop aimé ! Rien ne le montre mieux que L’homme aux loups ou L’homme aux rats, pour ne pas citer Schreber qui fit de cet amour incestueux un délire religieux[8]. Les conséquences de cette genèse de la culpabilité se vérifient tous les jours: c’est l’amour du père, la Vatersehnsucht qui éclaire non seulement la passion des foules pour un chef, mais aussi les lamentations des nostalgiques de la puissance paternelle[9]. La culpabilité ne concerne que cet amour du père dont le meurtre fut causé par le désir incestueux du fils, car qui oubliera que le désir incestueux vient d’abord des enfants? Cet amour renié déchaîne la jalousie du fils pour le frère, et l’on comprend ainsi également l’acte du «criminel sans remords», par exemple celui de l’intégriste qui commet ses crimes au nom des idéaux du père mort, et au titre de sa rédemption. Nos sociétés ne fonctionnent-elles pas toujours avec ce carburant? Elles sont puissamment structurées par l’amour du père, comme toujours sous la bannière de ses idéaux, c’est-à-dire au nom de la lutte contre son déclin, et pour sa rédemption, comme au premier jour de son meurtre.
À la fin de son premier chapitre, Zafiropoulos montre de quelle façon nos sociétés sont aveuglées par la même cécité meurtrière. Car en réalité, l’intégriste est-il bien le seul fou de Dieu à porter le poids du crime? Le capitaliste, lui aussi – et avec lui toute sa classe –, n’aperçoit même pas les souffrances énormes que sa domination engendre. Le lecteur impartial s’écriera aussitôt que le capitaliste n’est pas un fou de Dieu! Mais n’est-ce pas une drôle d’idée de croire que notre capitaliste serait sans Idéal ? Comme pour tout le monde, sa férocité lui tombe du ciel. Car Max Weber a bien montré que l’esprit du capitalisme répond du commandement luthérien du Bon Semeur (Beruf). À construire la cité de Dieu sur terre, les riches sont les Élus, et les pauvres les Damnés, sans pitié ni pardon. Laïcisée, cette règle ségrégative met en acte la « concurrence » (qui n’est nullement nécessaire à l’extraction de la « plus-value »). La mondialisation obéit à ce Beruf théologico-politique, triste servante de ce Père implacable, plutôt que d’une «jouissance» qui partout se refuse. Oui, le capitaliste n’a rien d’un jouisseur et son puritanisme le laisse sous la coupe du père divin. C’est d’ailleurs écrit sur chaque dollar : «In God We Trust». Le trust s’est peut-être laïcisé, mais chaque billet vert n’en proroge pas moins une loi du père. Comme l’intégriste, le capitaliste ne voit pas son crime. Cette cécité organisée et ultra-médiatisée gomme la visibilité de plus de la moitié d’une population qui vit dans la précarité, et non dans une jouissance qu’une sorte de rêve théorique a construite. Je ne veux faire aucun amalgame entre des auteurs bien différents les uns des autres, et dont le rôle est essentiel dans la transmission de la psychanalyse. Mais n’y a-t-il pas un point de convergence entre leurs points de vue, par ailleurs divergents? Car un lecteur au courant de l’état réel du monde demandera dans quel espace mythique il faut raisonner pour croire que notre société serait celle d’une «jouissance sans limite» (J.-P. Lebrun) ou que nous serions tous prolétaires (C. Soler) ou bien en état de psychose ordinaire dans une époque dont l’Autre se serait absenté (J.-A. Miller)?
Le présupposé commun semble en tous cas, la chute libre du père qui serait assortie d’un retour en puissance du matriarcat, avec une montée en force de la psychose, ou du moins d’une introuvable «jouissance». Ce serait accréditer l’idée, en dépit des antécédents de Schreber, que les psychoses ne procéderaient que d’un ravage maternel. Pourtant, depuis les rêveries mythologiques de Bachofen, les anthropologues – dont Lévi-Strauss – sont unanimes à déclarer que le matriarcat n’a jamais existé[10]. Les filiations matrilinéaires – qui d’ailleurs existent encore – ont toujours prospéré sous la domination des hommes.
Cela veut-il dire que rien n’a changé, qu’un intangible amour du père reste toujours cet « attachement infantile » le plus fort, comme le remarqua Freud[11]? Non, il y a du nouveau et il faut le constater, ou plutôt démasquer une constante à travers de nouvelles présentations du père. Le père idéal des croyants lui-même a modifié sa grimace : l’intégrisme lui a donné un sens que n’eurent pas les religions passées. Un athéisme pratique a infiltré jusqu’au cœur de la foi, et la violence de sa réaction caractérise une nouveauté du rapport au père. Le règne de la marchandise n’en est pas l’antonyme qui débriderait une jouissance affolée : il est régi par une loi paternelle d’airain, si bien explicitée par le poids de «la Dette», qui partout empêche la jouissance. Ce sont ces caractéristiques inédites qui ont présidé au baptême du fascisme, qui n’exista jamais en aucune autre époque. Il faut le regarder en face puisque son ombre lepéniste menace en France, de même d’ailleurs que les caractéristiques communes des divers Intégrismes: la haine du féminin, le recours à un livre unique, la dénonciation de la science et des générations montantes que l’on retrouve à l’œuvre aussi bien dans chacune des religions que dans leurs avatars athées qui infiltrent jusqu’au mouvement psychanalytique.
Il faudrait reconnaître et discuter les agencements nouveaux du complexe paternel entre père vivant et père mort[12]. Mais en attendant, la « permanence du complexe paternel » et du « monument religieux » au cœur du lien social restent des réalités incontournables. Il serait peu réaliste de soutenir que rien n’a changé ni ne changera. Au contraire, tout évolue toujours plus vite, justement grâce au déclin du père qui est le moteur symbolique de l’histoire… Mais rassurons-nous, c’est un déclin aussitôt suivi d’une renaissance, comme le veut l’ambivalence du complexe paternel, moteur inépuisable de progrès. Notre époque il est vrai, fusille sans merci le patriarcat… Tant mieux ! C’est une refondation de la Loi. On se demandera donc si le terme d’«évolutionnistes» que Zafiropoulos emploie pour qualifier les tenants de la déclinomanie est bien le plus approprié, car comment contester qu’une évolution est en cours, même si elle ne change en rien la structure[13] ?
Je voudrais maintenant dire ce qui me paraît donner une clé novatrice pour la lecture de ce livre. Elle est évoquée en peu de pages[14] : elle concerne la question du « désir du père » et de ce qu’il a de meurtrier. Citons le texte : « Ainsi doit-on compléter l’analyse de la haine inconsciente du fils pour le père par celle du père pour sa propre créature ». Voilà sans doute un programme de recherche à venir, mais il ouvre des perspectives à plusieurs questions posées dans cet ouvrage. Il faut bien l’avouer : la question « Qu’est-ce qu’un père ? » a été dégagée et martelée par Freud, comme l’a souligné Lacan. Mais ces deux maîtres ne l’ont pas abordé sous le jour du « désir du père ». Dans la Question préliminaire par exemple, Lacan réduit le « désir du père » à « la place que lui accorde la mère. » N’est-ce pas un peu court ? Car qui nierait l’existence d’un « désir du père » puissant, d’abord celui d’avoir des enfants, et cela indépendamment du « désir de la mère » ? Et il faut mesurer ensuite la violence de ce désir ! Comme le « premier père » du mythe grec d’Œdipe le dit pourtant : c’est un père meurtrier ! Comment comprendre cette violence, sinon grâce à celle du désir lui-même ? Car le fils qui devient père veut d’abord se débarrasser de son propre état de fils : c’est une répétition qui va le rendre plutôt méchant, puisqu’il prend ainsi la place d’un mort – c’est inconfortable. On ne trouvera jamais d’« essence du père », mais un complexe paternel, qui ne se comprend que dans la dialectique du fils au père et d’ailleurs de son Saint Esprit, c’est-à-dire de son parricide. Le fils «tue» son père en le devenant… mais alors, avec quelle gueule de bois totémique se réveille-t-il? Personne, et surtout pas le père, ne saurait dire «non» à la castration, sauf sous le coup d’une ivresse patriarcale, dans le genre de celle de Noé.
Il vaut donc mieux parler du « complexe paternel » des fils, qui les fait père dans l’ivresse du déclin: ils s’identifient au père en le devenant, inconscients de leur parricide fantasmatique, et sentant grandir en eux la détestation des générations montantes qui vont les vouer au même sort et auxquelles ils promettent des pathologies apocalyptiques… Cette haine, il est vrai, a jusqu’à un certain point un effet structurant : elle commande l’angoisse de castration et le rêve des fils d’en finir avec ces pères et leurs rêves d’exception. Dans cette obscurité, le lecteur nyctalope en tirera pourtant l’idée que la puissance du sentiment de déclin est proportionnelle à celle du refoulement du fantasme parricide. De sorte que des sociologues aussi prestigieux que Durkheim, et après lui Lacan avant sa rencontre avec Lévi-Strauss, et encore après lui une bonne partie de ses élèves, ont la certitude du déclin, à l’encontre des données pourtant bien établies par l’anthropologie et la sociologie. Ces données sont cependant des montagnes, comme la permanence de l’amour du père dans l’orientation des foules politiques et la force d’un intégrisme plus ou moins larvé, en tout cas en Europe. Quant aux usa, il faut noter une particularité de leur féminisme, obsédé par la condamnation des pères violeurs, d’ailleurs toujours réaffirmés ainsi dans leurs rôles dominants. Zafiropoulos fait ici un joli parallèle entre la haine des fils pour le père «à l’Est» et les procès intentés par les filles « à l’Ouest » de l’Atlantique[15]. C’est une répartition géographique amusante, qui correspond à une forte réalité sociologique facile à vérifier. Cette distribution des deux côtés de l’Atlantique est bien l’envers et l’endroit d’une même domination fantasmatique de notre père. Un même complexe comporte ces deux faces plus ou moins accentuées d’un côté ou de l’autre, ce qui sera aussitôt clair pour ceux qui ont compris que la « castration » correspond à une angoisse de « féminisation virilisante » – c’est-à-dire une instable et permanente bisexualité psychique. La mise en scène des filles et des garçons entre les deux rives de l’océan est une jolie parabole de cette bisexualité.
Avec notre clé en poche, suivons maintenant la généalogie des idées concernant le « déclin du père » dans le mouvement psychanalytique. Le lecteur curieux accompagne pas à pas le parcours de Lacan, qui semble bien avoir découvert Freud en marchant à reculons, et cela pendant une bonne partie de son trajet. Son option de départ fut celle de Durkheim, c’est-à-dire – en effet – celui d’un déclin du père, pour ensuite retourner à Freud et au mythe de Totem et tabou grâce à Lévi-Strauss[16]. Lacan découvrit encore plus tardivement la pluralité des noms du père, c’est-à-dire, au fond, rien d’autre que la bivalence du complexe paternel, dont la haine est certes unique et fondatrice au premier jour, mais dont le versant amoureux comporte de multiples enveloppes formelles : de nombreuses variantes religieuses, mais aussi d’infinies particularités singulières. Dans le Lacan millésimé 1938 des « Complexes familiaux », les idées de Durkheim dominent : on y voit une famille rétrécie au père fluet, et on découvre sans surprise dans ce texte une panoplie de pathologies telles qu’elles se déclinent à nouveau aujourd’hui[17]. Un attachement hypertrophié à la mère porterait seul la responsabilité de ces pathologies : anorexie mentale, suicide, toxicomanie, troubles narcissiques, violences sociales, etc. L’effacement du père est décrit comme une évidence et le lecteur n’est pas dépaysé, s’il connaît les écrits de nombreux lacaniens comme d’ailleurs de membres de la spp qui portent des diagnostics équivalents. Ces thèses sont soutenues aussi par de nombreux auteurs américains, qui mettent sur le compte de la famille éphémère, immigrée, recomposée, etc., l’extension de pathologies narcissiques identitaires ou d’états limites étendus à l’infini. Le lecteur est en tout cas content d’apprendre que la déclinomanie ne contamine pas seulement les rangs lacaniens.
Mais il l’est encore plus d’apprendre que selon les études des ethnologues et des anthropologues un peu documentées et sérieuses, il n’a jamais existé dans le passé de ces larges familles bien structurées qui auraient donné son assise à ce symbolique de qualité qui aurait fleuri jadis, et qui est l’objet des actuelles déplorations[18]. Les grandes familles bien installées existèrent sans doute dans l’aristocratie et la bourgeoisie montante, mais ce ne fut jamais le cas pour l’immense majorité des familles européennes. Avant le xviie siècle, les famines annuelles chassaient de leur foyer un grand nombre de pères qui partaient à l’aventure. Les orphelinats étaient pleins. Entre le xviiie et le xixe siècle, les familles monoparentales abondaient : 25 à 30 % des enfants étaient confiés à des nourrices à la campagne et 25 à 30 % d’entre eux mourraient avant de revoir leurs parents. Contrairement à l’imaginaire socio-clinique actuel, la forme conjugale restreinte de la famille a toujours dominé. La loi lacano-durkeimienne de la contraction historique de la famille en Occident est donc scientifiquement bien fragile. Elle ne repose sur aucune recherche connue, mais sur une simple affirmation, une intuition qui doit sans doute sa force à la haine du père pour les générations montantes. Ce n’est pas une grande nouveauté. Au premier siècle de notre ère, Horace la décrivit déjà dans ses Odes : « / Aetas parentum, pejor avis, tulit / nos nequiores mox daturos / progeniem vitiosiorem. / » : « La génération de nos pères, qui valaient moins que nos aïeux, a fait naître en nous des fils plus méchants, qui vont donner le jour à une génération plus mauvaise encore ».
Comment peut se conclure le diagnostic apocalyptique porté sur les nouvelles générations, sinon par un appel à la restauration de l’autorité paternelle[19] ? Le tableau prend une tournure encore plus inquiétante lorsque du côté lacanien cette crise de l’autorité est spécialement étudiée chez l’enfant de l’immigré qui serait « un père sans nom[20] ». Un lecteur inquiet se demandera ce qui sépare ces frayeurs du sentiment d’insécurité diffusé par les médias, thèses d’ailleurs reprises par des organisations politiques discutables. Il faut encore ajouter à ce tableau que l’origine de la crise de l’autorité est souvent attribuée à la liberté des mœurs, aux progrès de la science et finalement à la Révolution française[21]. Zafiropoulos apporte des statistiques et des faits précis. La criminalité n’est pas plus importante dans le milieu immigré que dans le milieu autochtone : 90 % des étrangers emprisonnés le sont parce qu’ils sont « sans papiers[22] ». De plus, la criminalité dans ce milieu est plutôt en baisse. Quant aux conduites à proprement parler criminelles, elles se produisent pour la plupart au sein de ces fameuses familles patriarcales qui seraient si bien structurées par nos traditions, mais où la haine mijote[23]. Cette criminalité proprement dite a d’ailleurs baissé elle aussi : en un siècle, elle est passée de 19 pour 100 000 habitants à 4,5 pour 100 000 habitants.
Là encore le lecteur – a priori indulgent – se dira que ce n’est pas l’ignorance sociohistorique qui amène à diagnostiquer une catastrophe en cours du « symbolique », ou à décrire la vie dans les cités comme une apocalypse postmoderne. N’est-ce pas plutôt la position de discours d’un patriarcat menacé depuis les Lumières, et encore plus depuis les débuts de la psychanalyse. Peut-on dire avec Zafiropoulos que ce sentiment si partagé du déclin trouve sa source dans le jeune Lacan et avant lui dans les travaux de Durkheim ? Peut-être n’y a-t-il pas besoin d’aller chercher si loin, car le « désir du père » – et sa haine pour les générations montantes – l’explique à lui seul. D’autant que le virage de Lacan fut complet en 1953 dans le « Rapport de Rome », et cela sous l’influence avouée et reconnaissante de Lévi-Strauss, qui mit à jour dès 1950 la fonction sémantique du « signifiant flottant » ou d’un « signifiant d’exception », « dont le rôle est de permettre à la pensée symbolique de s’exercer[24] ». C’est le précurseur direct du « point de capiton », ou encore du « Nom du père ». Sur ce point si central, Lacan devint freudien, et du même coup il reprit à son compte ce que Lévi-Strauss emprunta à Saussure et à Jakobson. Ce fut l’entrée en scène du structuralisme dans le champ de la psychanalyse, et cette filiation importe pour l’une des plus importantes découvertes de Lacan : le « Nom du père [25] ». Il est vrai que « la valeur symbolique zéro » de Lévi-Strauss n’était pas encore le « point de capiton », puisque pour Lévi-Strauss, ce signifiant – qu’il déchiffre dans le mana, le hau, le nahual, ou l’aurenda – est ce qui permettait – selon lui – de combler l’écart entre le signifiant et le signifié[26]. Au contraire, si ce mana représente l’esprit du père parricidé, il engendre le refoulement et, par conséquent, il crée un écart entre le signifiant et le signifié. Il n’en reste pas moins que si « l’institution zéro » est bien le tombeau du père, c’est bien elle qui est le moteur de la parole du sujet qui cherche à se disculper en chacune de ses phrases. La respiration du mana rythme le symbolique qui court le long de chaque énoncé, de la mort à la résurrection du père. C’est bien un écart qui est ainsi creusé entre les représentations de mots – qui deviennent seulement ainsi « symboliques » – et la pulsionnalité des représentations de choses freudiennes. Le terme nouveau de « signifié » leur donne un statut de beaucoup rétréci, mais il a ouvert une autoroute aux immenses extensions de la linguistique.
Le lecteur tatillon s’étonnera peut-être du titre du chapitre 6 : « La subversion de la théorie freudienne de la féminité par Lacan ». Que vient faire la féminité dans un livre centré sur le complexe paternel ? Rien de surprenant pourtant, puisque le « désir du père » est orienté par et vers le féminin : ce monstre ne s’est pas beaucoup renouvelé, depuis ses excès orgiaques de la horde primitive ! Dans son analyse de Dora, Lacan a montré que cette jeune fille a comme idéal la vierge, c’est-à-dire la femme inconsciente du père – une fois mort[27]. C’est bien en effet une représentation de la perspective dernière du « devenir féminin », celui qui s’impose comme un idéal impossible, mais constant. La jouissance mystique elle-même, loin d’être supplémentaire, reste articulée au désir du père, fut-il éternel. Les mystiques jouissent de Dieu en répétant son nom. De même que la question « Qu’est-ce qu’un père ? » fut bien posée, mais que ses attendus furent si contradictoires que la réponse resta évasive, de même la question « Que veut la femme ? » resta elle aussi en suspens à la fin de la vie de Freud. Ces deux questions se répondent.
Une lectrice avertie pensera que, depuis les critiques de Judith Butler[28], ce chapitre six mérite une discussion, et même une polémique. Car est-il si évident que la théorie de Freud serait tombée dans une impasse, qui aurait été « surclassée » par Lacan ? N’est-il pas approximatif de soutenir que Freud aurait considéré que la maternité était le destin de la féminité ? Pour Freud, le « devenir féminin » parcourt trois étapes : une masculinité première…, une féminité dernière, mais impossible d’accès – justement parce qu’elle correspond au désir incestueux du père… Et, entre ces deux extrêmes, une voie moyenne suivie par une majorité des femmes qui oscille entre masculin et féminin, ce qui correspond bien à la question centrale de l’hystérique : « Suis-je un homme ou suis-je une femme ? » La maternité ne correspond à aucune de ces trois étapes que Freud distingua clairement, même si cette maternité est la bouée de sauvetage à laquelle se raccroche une femme, dans l’impossibilité où elle se trouve de répondre aux contradictions du devenir féminin. Freud constata donc seulement que cette issue de secours est empruntée par une majorité de femmes : c’est un fait, mais c’est aussi la voie de leur asservissement, comme il l’a fortement souligné dans son texte de 1908[29]. Selon lui, les femmes « déçues par le mariage tombent dans de sévères névroses qui assombrissent toute leur vie ». Comme Zafiropoulos le rappelle pourtant lui-même[30], Freud écrivit dans ce texte étonnant que le mariage est des plus nocifs pour la sexualité féminine, puisqu’il l’oriente essentiellement vers la maternité, et cela pour le plus grand dommage de son désir. Freud ne se départira jamais cette position révolutionnaire, qui montre que la féminité est contredite par la maternité. Rien de plus cohérent avec son point de vue général puisque – si « l’enfant phallus » calme le Penisneid – du coup le désir sexuel est étouffé. Il est vrai que Freud témoigne d’une hésitation certaine dans une série d’articles successifs, concernant le complexe d’Œdipe chez la fille. Mais il ne contredit jamais son affirmation de principe de 1908 et dans son texte de 1925 « Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique des sexes », il ne peut faire mieux que de mettre en parallèle le motif de son indécision et l’incertitude de la féminité elle-même, qui tient à sa bisexualité, c’est-à-dire à l’introuvable solution de la question féminine concernant son devenir. Du fait de la prédisposition bisexuelle, écrit-il, « Le contenu des constructions théoriques de la masculinité pure et de la féminité pure reste incertain ».
Il faut souligner l’apport théorique ou plutôt la précision décisive apportée par Lacan sur la question. Il a montré que le symbole phallique ne se réduit pas au pénis, et qu’en ce sens, ni l’homme ni la femme ne possèdent le phallus. Un homme n’a le phallus, c’est-à-dire le pénis en érection, que dans la mesure où il désire une femme, qui en est donc tout aussi bien propriétaire. Le phallus ne s’érige que dans l’entre-deux du désir : c’est le symbole même du désir, ou encore de la castration, puisque, du coup, l’homme est dépossédé plus souvent qu’à son tour de ce phallus qui n’en fait qu’à sa tête. Mais il faut tirer les conséquences de cette clarification. C’est que les hommes comme les femmes sont « castrés ». Il est clownesque de soutenir que les hommes « auraient » le phallus alors que les femmes ne l’auraient pas, comme si les hommes n’étaient pas castrés alors que les femmes le seraient (!).
Mais si notre lectrice avertie mais pas encore en colère souscrit aux critiques de Judith Butler, elle va alors se demander si une dialectique discutable de l’Être et de l’Avoir n’a pas emporté Lacan vers un horizon problématique. Car peut-on soutenir que les hommes « auraient » le phallus alors que les femmes le « seraient » ? Ce fut pourtant la position constante de Lacan depuis son texte sur « La signification du phallus », et il l’affirma par exemple en décrivant « cette identification profonde au signifiant phallique qui est le plus lié à sa féminité[31] ». On connaît la conséquence ultime de cette position : elle tombe comme la foudre : « la Femme n’existe pas ». On pourrait à la rigueur retenir cet aphorisme au ton présocratique, s’il ne concernait que le stade ultime de la marche vers la féminité, idéal irréel en effet. Mais sa globalité balaie d’un revers de main toute la dialectique du devenir femme. Elle est bien éloignée en tous cas de la délicatesse de Freud qui se contenta d’écrire qu’il était hors de portée de définir la femme[32].
Ni la femme ni personne ne peut « incarner » l’être du phallus, même sur l’horizon suicidaire et transsexuel des psychoses. Tout sujet, dès sa naissance, entre dans la dialectique de l’avoir selon les modes contrastés du masculin ou du féminin. Tout sujet rejette l’identification au phallus dès qu’il naît. L’autiste lui-même résiste. C’est l’Austossung freudien. Zafiropoulos qui soutient plutôt le point de vue de Lacan, ajoute en commentaire qu’il s’agirait « in fine de s’identifier à l’objet du désir de l’Autre[33] ». Vraiment ? Car comment la féminité pourrait-elle se définir par une identification au désir de la mère ? Elle s’en démarque au contraire via le désir du père[34] ! « Psychotiser » la Femme n’est pas une solution. Le tabou universel de la virginité montre au contraire que la fille est l’objet du désir du père et non celui de sa mère, qu’elle chercherait à satisfaire. Pour sa mère, une fille pourrait être un objet phallique… mais elle ne saurait y parvenir, et elle la prend en haine pour cette raison, comme le montrent l’anorexie psychotique – presqu’exclusivement féminine – et ses délires d’empoisonnement[35]. La frappe de l’aphorisme lacanien a un dernier inconvénient : c’est une formule qui convient à merveille au patriarcat de toujours. Finalement les hésitations de Freud ne sont-elles pas plus éclairantes que l’affirmation de Lacan ? On reprochera avec raison à Freud quelques flottements datés marqués par l’esprit de son époque[36], mais, sur le fond, ses incertitudes s’appuient sur la réalité de faits qui ne relèvent même pas de la clinique, mais sur celles de la bisexualité ordinaire – que Lacan a d’ailleurs plutôt méconnue.
Enfin, les derniers chapitres nous font marcher sur des œufs, puisqu’on mesure comment, d’une façon ou d’une autre, certains de nos collègues éminents ou de nos amis endossent les intuitions de la « déclinomanie » comme s’il s’agissait d’évidences, alors qu’ils contredisent sans doute l’ordinaire de leur propre clinique qui répond toujours – parions-le – de l’orientation de la structure, à savoir : psychose, névrose, perversion. On entend souvent dire que les associations lacaniennes souffriraient d’un dogmatisme étroit, et que se chante partout une messe unique. Les mauvais esprits ajoutent que cette langue de bois est en réalité au service de la légitimation de chefferies institutionnelles et du confort de groupe. C’est une erreur. Car derrière ce dogmatisme de façade, de nouvelles thèses sont apparues presque partout, selon une orientation plutôt sociologique, qui inclinerait à porter un diagnostic – celui d’une crise du « Symbolique » en effet –, voire qui suggéreraient un remède, celui du renfort de l’autorité. Ces ouvertures nouvelles ont une autre caractéristique étonnante, c’est qu’elles vont toutes dans le même sens. Pourquoi ? C’est un mystère.
On aurait pu s’attendre à des inventions, à des simplifications qui se produisent lorsque la recherche a longtemps pataugé. On aurait pu s’attendre à des réponses aux questions laissées en suspens. Et par conséquent à des divergences. Mais non, pas de cacophonie. N’en va-t-il pas ainsi parce que ces nouvelles perspectives accompagnent à l’unisson la berceuse jouée par l’air du temps ? Ce programme pourrait avoir son intérêt, s’il n’avait pour seul argument la rumeur du déclin, avec si peu de preuves anthropologiques ou cliniques. Il débouche sur un éparpillement de la structure qui donne le frisson, car au fond il n’est pas si éloigné de la dispersion des troublantes classifications dsm. C’est vrai pour les théoriciens de l’ipa, mais aussi pour ceux qui nous sont proches, qu’il s’agisse de « la psychose ordinaire » de Jacques-Alain Miller, de « L’homme sans gravité » de Charles Melman, ou même de « l’inconscient réel » de Colette Soler. Je le répète encore une fois, je voudrais me contenter de poser questions qui me semnment cruciales. Selon Colette Soler[37], le capitalisme « serait comptable de la chute des grands semblants : Dieu, le père, la femme, etc., au profit des seuls commandements de la marchandise, du pousse-à-la-consommation qui homogénéise sans passer par l’universel des idéaux de la tradition et qui défait même la foule freudienne appendue à l’exception paternelle. » D’ailleurs, Colette Soler écrit aussi : « je ne crois pas que Lacan ait jamais été structuraliste… ». N’est-on pas tout près d’une version d’un inconscient hors symbolique[38] ? Un inconscient qui répondrait désormais aux commandements d’un pousse-à-jouir collectif. Colette Soler écrit encore à propos du capitalisme : « Son programme de jouissance met à mal non pas la sexualité en tant que telle mais la libido socialisante au profit des grands agrégats de corps prolétaires n’ayant plus rien pour faire lien social ».
Selon J.-A. Miller, le dernier enseignement de Lacan serait celui où « l’Autre n’existe pas » et il ouvrirait une sorte de période de l’autisme[39]. Mais on ignore à quelle clinique se réfère ce silence, en tout cas pas à celle des analysants, qui, comme depuis l’époque du Lacan structuraliste, continuent de fonctionner dans la dialectique de leur rapport à l’Autre[40]. Bien que sa pensée ait toujours été nuancée, comme il convient à un chercheur, il est possible que Lacan ait fait des hypothèses aussi tranchées. Il n’en continua pas moins de faire ses présentations cliniques à Sainte-Anne, où seul le dégagement de la structure l’intéressait. Mais admettons que telles furent ses perspectives théoriques : en a-t-il tiré les perspectives sociologiques apocalyptiques, qui ravalent la psychanalyse du rang d’avant-garde à celui d’arrière-garde ? Comme s’il avait suffi que Lacan le décrète (si tant est que cela ait été le cas) pour que les patients se dispensent de leur rapport à l’Autre, donc de la structure ! Bien plus, ce ne serait pas seulement les patients, mais la société tout entière qui vivrait désormais dispensée de tout Autre. Sans doute notre société a-t-elle sa mythologie, dont l’autiste et le psychopathe pervers sont des héros sans conteste. Sans doute le mythe est-il jusqu’à un certain point, producteur de la réalité psychique, et en ce sens J.-A. Miller en montre la vérité. Mais faut-il faire la même erreur que Bachofen qui, sur le fond des mythologies de l’Antiquité, affirma la puissance d’un matriarcat archaïque ? C’était confondre le Mythe et l’Histoire. Le mythe produit l’encre qui permet à la seiche de s’échapper, mais on ne voit pas que notre époque soit celle d’une société liquide et sans structure. Et le lecteur inquiet demandera maintenant en quoi cet imaginaire du collectif, ou de la clinique correspond à quelques faits ? On voit se profiler une sorte de dégagement qui a tout juste une allure sociologique, puisqu’il manque d’une information détaillée et d’au moins un cas clinique convaincant. Ce cas clinique ne viendra jamais, puisque les nouvelles pathologies évoquées, que ce soient les violences sociales, les troubles somatoformes, les pathologies narcissiques, le pullulement des états limites, les psychoses sans délires ni dissociations résistent à la psychanalyse et que – tout occupés à « consommer » – ces nouveaux malades ne vont surtout pas voir de psychanalystes. C’est donc avouer que nos collègues n’ont – en fait – aucune expérience clinique de ces nouvelles pathologies, qu’ils en ont seulement entendu parler (dans les médias) et qu’en réalité leur clinique ordinaire continue de répondre à la structure : psychose, névrose, perversion. Il faudrait donc expliquer de l’inconnu (de nouvelles pathologies) par du plus inconnu encore (la dégringolade du père dans la société). Ignotium per Ignotius, c’est une rhétorique imparable.
J’ai refermé ce livre en pensant que Zafiropoulos avait fait un effort difficile, celui de situer la progression de la psychanalyse selon sa généalogie. C’est vraiment difficile, dans le climat d’hypnose religieuse qui gèle actuellement les débats. S’il existe une généalogie, n’a-t-elle pas une suite ? Et si les questions laissées en suspens par Freud ou Lacan ne sont pas des réponses, ne faut-il pas continuer d’y réfléchir ? La conclusion est claire et les enjeux importants si, comme il l’écrit, la déclinomanie remet en cause « les enjeux de la révolution freudienne devenus de ce point de vue enterrés ». Je me suis dit que Markos risquait bien de voir diminuer le cercle de ses collègues et amis. Mais qu’il se rassure car, si tant est qu’il soit lu comme il le mérite, si tant est qu’il soit compris selon la prudence et la modestie de son propos, si tant est qu’il soit invité à en débattre, il entendra claquer sur lui la porte du dogmatisme, tant sont enracinées les croyances de groupe. J’espère que je me trompe, au moins sur ce dernier envoi.
——————————————————————————
[1] M. Zafiropoulos, Du père mort au déclin du père de famille. Où va la psychanalyse ?, Paris, Puf, 2014.
[2] Ibid., p. 53.
[3] Dans une interview donnée lors de sa visite au Pape, par exemple, Shimon Peres, ancien président israélien, déclara qu’« en prenant acte du fait que l’onu a fait son temps, ce qui nous servirait, c’est une organisation des religions unies, une onu des religions. »
[4] M. Zafiropoulos, Du père mort au déclin du père de famille. Où va la psychanalyse ?, op. cit., p. 44.
[5] Conquête d’autant plus tentante aujourd’hui que le sol de sa région regorge de pétrole.
[6] C’est une réalité clinique vérifiée dans les cures. Il est vrai qu’on peut faire une objection à cette lecture comme le fait Zaphiropoulos à la page 38 en mettant en avant le cas de la mélancolie. Mais c’est plutôt une confirmation, puisque la mélancolie est un arrangement pathologique où aucun symbole du père n’est intériorisé pour prendre le relais de la culpabilité et en faire un épineux amour du père ! Le Freud clinicien ne s’oppose pas au Freud historien.
[7] M. Zafiropoulos, Du père mort au déclin du père de famille. Où va la psychanalyse ?, op. cit., p. 37 et 50.
[8] La mère n’est présente dans cette scénographie de l’origine que parce qu’elle soutient son fils contre le père et fait de lui un héros (un de ces héros qui font décliner le père).
[9] M. Zafiropoulos, Du père mort au déclin du père de famille. Où va la psychanalyse ?, op. cit., p. 75.
[10] Ibid., cf. chapitre VIII, « Qu’est-ce que le matriarcat ? »
[11] Cf. Freud Le malaise dans la culture : « Un besoin provenant de l’enfance aussi fort que la protection paternelle, je ne saurai en indiquer ».
[12] Quiconque passe à la sortie des écoles verra que les pères sont nombreux dans la foule de parents qui attendent les enfants. Oui, il y a un nouveau rapport à la paternité, beaucoup plus responsable.
[13] M. Zafiropoulos, Du père mort au déclin du père de famille. Où va la psychanalyse ?, op. cit., p. 153.
[14] Ibid., p. 52 et sq.
[15] Ibid., p. 57.
[16] Ibid., p. 100.
[17] Ibid., p. 144.
[18] Ibid., p. 71.
[19] Ibid., p. 76.
[20] Ibid., p. 74.
[21] Ibid., p. 89.
[22] Ibid., p. 79.
[23] Ibid., p. 83.
[24] Cf. C. Lévi-Strauss, Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss, Paris, Puf, 1950.
[25] M. Zafiropoulos, Du père mort au déclin du père de famille. Où va la psychanalyse ?, op. cit., p. 104.
[26] Ibid., p. 117.
[27] Ibid., p. 135.
[28] Cf. J. Butler, Gender Trouble : Feminism and the subversion of identity, New York, Routledge, 1990.
[29] S. Freud, « La morale sexuelle civilisée et la maladie nerveuse des temps modernes » (1908), dans La vie sexuelle, Paris, Puf, 1969.
[30] M. Zafiropoulos, Du père mort au déclin du père de famille. Où va la psychanalyse ?, op. cit., p. 14.
[31] J. Lacan, Le séminaire, Livre V, Les formations de l’inconscient (1957-1958), Paris, Le Seuil, 1998.
[32] À partir de prémisses bien différentes, Judith Butler arrive aux mêmes conclusions.
[33] M. Zafiropoulos, Du père mort au déclin du père de famille. Où va la psychanalyse ?, op. cit., p. 132.
[34] Cf. S. Freud, « Le tabou de la virginité » (1918), Revue française de psychanalyse, vol. 6, n° 1, 1933.
[35] Cf. S. Freud, « La féminité » (1932), dans Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, trad. fr. M. R. Zeitlin, Paris, Gallimard, 1984.
[36] M. Zafiropoulos, Du père mort au déclin du père de famille. Où va la psychanalyse ?, op. cit., p. 131.
[37] C. Soler, L’inconscient réinventé, Paris, Puf, 2009.
[38] M. Zafiropoulos, Du père mort au déclin du père de famille. Où va la psychanalyse ?, op. cit., p. 136.
[39] Cf. JA Miller, « Le dernier enseignement de Lacan », La Cause Freudienne, n°51, 2002.
[40] M. Zafiropoulos, Du père mort au déclin du père de famille. Où va la psychanalyse ?, op. cit., p. 112.